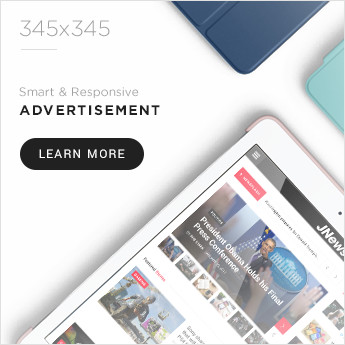Par : Is-Deen TIDJANI
© BOULEVARD DES INFOS
En République du Bénin, le débat politique s’anime depuis quelques jours autour d’un projet majeur : la révision de la Constitution pour y instaurer un organe décisionnel dénommé le Sénat. Présenté le vendredi 31 Octobre 2025 à la faveur de la deuxième session ordinaire de l’année 2025, par les députés Bonaventure Natondé Aké et Assan Séibou, présidents des deux groupes parlementaires de la mouvance présidentielle (Union Progressiste le Renouveau et Bloc Républicain), le projet de révision qui vise la création du Sénat ambitionne un meilleur équilibre institutionnel. Mais cette proposition de réforme pensée par les soutiens du pouvoir, soulève autant de questionnements que d’espoirs dans le rang de l’opposition radicale qui s’interroge sur son opportunité. Dans le registre des contestataires, Thomas Boni Yayi, ancien président du Bénin et Chef du principal parti d’opposition, hausse le ton. Dans un message officiel, il rejette non seulement la proposition, appelle ses députés encore fidèles à faire barrage avec leur “minorité de blocage” et lance « (…) Je ne saurais en aucun cas faire partie de cette institution comme membre de droit ni cautionner un tel projet». Tout comme lui, d’autres voix critiques comme Célestine Zanou et Candide Azannai ont tiré la sonnette d’alarme. Mais bien loin des intrigues politiques et politiciennes, il sied de s’intéresser aux motivations de cette réforme.
Au nom de la préservation et de la stabilité
À en croire les instigateurs de cette proposition de révision, l’instauration d’un Sénat vise entre autres à : Concourir à garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis de développement de la Nation, de défense du territoire et de sécurité publique. À ce titre, il veille à la stabilité politique, la continuité de l’État et au débat politique contradictoire constructif ; Assurer la promotion des mœurs politiques conformes à la sauvegarde des intérêts supérieurs de la Nation, de l’unité et de la cohésion nationale, du développement et de la paix sociale ; Veiller à renforcer les libertés publiques, la qualité de gestion des biens publics, l’unité et la concorde nationales en vue de développement humain équilibré et durable…
Toujours selon la partie défenderesse, cette réforme permettra au Sénat de délibérer à priori sur tout projet ou proposition de loi à caractère politique, notamment en ce qui concerne la d’évolution ou l’organisation du pouvoir d’État.
Dans la même directive, le Sénat peut solliciter une seconde lecture de toute loi votée à l’Assemblée Nationale excepté les mois de finances et assimilées.
Une tendance africaine !
Si la proposition de révision en cours au Bénin aboutit, la mise en œuvre du sénat deviendrait non seulement une réalité, mais le Bénin ferait ainsi son entrée dans le rang des pays africains ayant expérimentés ce mécanisme à l’image de la Côte d’Ivoire, du Rwanda, du Sénégal ou encore du voisin le plus proche, le Togo.
Pour rappel, l’idée d’un Sénat n’est pas nouvelle en Afrique. Plusieurs pays ont déjà adopté ce modèle, même si chacun d’eux s’y aventure selon ses réalités politiques.
En Côte d’Ivoire par exemple, le Sénat, créé en 2018, a pour mission principale de représenter les collectivités territoriales. Il joue un rôle consultatif important, mais reste souvent perçu comme une institution dominée par l’exécutif.
Au Rwanda de Paul Kagamé, le Sénat instauré après la Constitution de 2003, veille à la cohésion nationale et à la continuité de l’État. Sa composition, partiellement nommée, vise à garantir la diversité et la stabilité du pays après le génocide meurtrier dont personne n’ignore les dégâts.
Au pays de la téranga (Sénégal), le Sénat a connu un parcours discontinu : supprimé en 2001, rétabli en 2007, puis de nouveau aboli en 2012 pour raisons budgétaires et symboliques. L’expérience sénégalaise montre en effet, les limites d’une chambre haute en déphasage avec les réalités politiques du pays.
Chez Faure Gnassingbé, au Togo, le Sénat est prévu par la Constitution de 1992, mais n’a jamais été mis en place malgré plusieurs annonces. Dans sa 5ème République, le Togo a instruit le Sénat fondé sur la logique territoriale et non sur l’ancienneté. Pour les élites de ce pays proche du Bénin, cette tergiversation témoigne des difficultés d’adaptation du bicamérisme aux contextes institutionnels fragiles.
Entre inspiration et prudence
Le Bénin, souvent cité comme modèle démocratique en Afrique de l’Ouest, semble vouloir s’inspirer des expériences voisines tout en évitant leurs écueils. C’est du moins ce que traduit la composition des membres de droit qui devront siéger au sein de ce Sénat. En effet, selon la monture proposée par les initiateurs de la proposition de révision, le futur Sénat sera composé des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l’Assemblée nationale, des anciens présidents de la Cour Constitutionnelle, des chefs d’Etat-major des forces chargés de la défense et de la sécurité nationale. Mieux, en dehors de ces personnes tous membres de droit, la proposition souhaite que le Président de la République et celui de l’Assemblée nationale désignent chacun des membres dont le nombre constitue un quota qui n’excéderait pas au total 1/5 de ces membres de droit.
Un Pari pour la maturité démocratique ?
L’instauration d’un Sénat au Bénin marquerait sans aucun doute un tournant institutionnel majeur. Cependant, les cas de la Côte d’Ivoire, du Rwanda, du Sénégal ou encore du Togo doivent amener à négocier ce virage avec beaucoup de prudence et surtout de tactiques. Et pour cause, la réussite d’une telle réforme dépendra moins de la structure elle-même que de son ancrage dans la pratique démocratique. Si le futur Sénat devient un espace de réflexion et de représentation équilibrée, il pourrait consolider la démocratie béninoise. Mais s’il se transforme en simple chambre d’appui politique, il risquerait de n’être qu’une caisse de résonance, et du coup, le symbole d’un bicamérisme de façade.